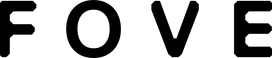Entre 1920 et 1933, les États-Unis interdisent l'alcool. Le Canada suit brièvement. Le Québec adopte une prohibition qui ne dure que quelques semaines en 1919, puis légalise à nouveau en 1921.
Ce qui suit n'est pas une résistance culturelle romantique. C'est une économie parallèle et une tolérance pragmatique face à une loi perçue comme étrangère.
Une frontière poreuse
Les régions frontalières comme le Témiscouata et les Cantons-de-l'Est deviennent des zones de passage. Alfred Lévesque, le « bootlegger du Témiscouata », dirige un réseau employant environ 800 personnes et utilisant près de 500 voitures pour transporter l'alcool vers les États-Unis.
À Abercorn, située à quelques pas de la frontière américaine, cinq hôtels sont en activité durant les années 1920. Le Palace of Sin chevauche la ligne frontalière entre Glen Sutton et East Richford, avec deux bars au rez-de-chaussée, l'un au Québec, l'autre au Vermont.
Une ville qui ne dort pas
À partir des années 1920, Montréal devient la « Paris du Nord ». Les musiciens jazz de New York ou de Chicago, comme Count Basie ou Duke Ellington, viennent présenter leurs spectacles dans le Red Light, où l'alcool coule à flots.
En 1924, Samuel Bronfman ouvre une distillerie à LaSalle. Les Bronfman vendent de l'alcool aux villes du nord des États-Unis depuis les environs de Montréal, où la production reste légale.
L'héritage paradoxal
C'est en 1921 que naît la Commission des liqueurs — l'ancêtre direct de la SAQ. Son mandat : générer des revenus après la guerre, contrôler la vente pour rassurer les groupes de tempérance, contrer la contrebande liée à la prohibition américaine.
Un compromis pragmatique pour une époque troublée.
Un siècle plus tard, le modèle tient toujours. Monopole d'État, contrôle strict, taxation élevée. Aujourd'hui, 72 % du prix d'une bouteille revient à l'État — taxes, marges, droits d'accise. Une structure née pour encadrer un problème disparu depuis longtemps, mais devenue une machine fiscale.
Pendant ce temps, les États-Unis comptent aujourd'hui plus de 3 000 distilleries. Le marché s'est diversifié, multiplié, réinventé.
Ici, nous restons une poignée à naviguer un système rigide, où chaque nouveau produit attend des mois avant d'atteindre une tablette.
Ce que cela dit de nous
L'alcool est la substance psychoactive la plus socialement acceptée au Québec. On la célèbre, on en fait un marqueur d'identité culturelle. On distille, on vieillit, on raconte des histoires autour d'elle.
Mais on ne peut pas la vendre directement. On doit passer par un réseau unique, où l'innovation attend l'approbation d'un comité.
Ce n'est pas de la prudence. C'est de l'inertie institutionnelle.
Le Québec n'a jamais vraiment cru à la prohibition. Mais il n'a jamais vraiment remis en question le système qui en est né.
Une question ouverte
Les bootleggers sont devenus des figures folkloriques. On aime se rappeler cette époque où le Québec contournait les règles imposées d'ailleurs.
Mais aujourd'hui, les règles sont les nôtres. Et elles figent un marché qui pourrait respirer.
Peut-être qu'un siècle plus tard, il serait temps de se demander si le contrôle hérité de la prohibition sert encore quelque chose — ou s'il ne fait que protéger une structure devenue sa propre raison d'être.